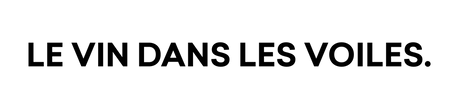Le vin orange, c’est fini?

Vous êtes tannés des vins oranges? Vous n’avez pas fini…
On entend de plus en plus souvent : « Le vin orange? J’en ai trop bu. C’est toujours pareil. Redonne-moi un bon blanc clair et droit. »
Ce genre de commentaire revient chez les pros comme chez les amateurs, à Montréal comme ailleurs. Comme si les vins de macération pelliculaire avaient perdu de leur éclat. Trop vus, trop bus, trop assimilés à une esthétique rigide : trouble, tannique, un peu funky, un peu lourd. Mais ce qu’on oublie trop vite, c’est que le vin orange n’est pas une mode — c’est une réponse. Une réponse au climat, à la vigne, à la fermentation, à la vie même.
Pour creuser un peu, on a tendu l’oreille à trois vigneron·ne·s qui connaissent le vin orange autant dans la vigne que dans le verre :
🔸 Silvia Tezza, femme-orchestre de Il Roccolo di Monticelli en Vénétie, cultive et vinifie avec une sensibilité fine — autant guidée par la nature que par l’avenir.

🔸 Stephanie Renner, du domaine Rennersistas en Autriche, vinifie dans le Burgenland avec son frère Georg, dans un style à la fois pur, vivant et profondément ancré dans leur terroir.

🔸 Joseph Mosse, vigneron au Domaine Mosse en Loire, partage son temps entre les vignes et Le Cercle Rouge, son nouveau bar à vin naturel à Angers, où il goûte, pense (et parfois boycotte) les vins de macération.

Quand la mode s’efface, il reste le sens
Silvia observe une vraie évolution dans la réception des vins oranges. Elle note que l’enthousiasme des débuts s’est dilué, en partie parce que ces vins sont souvent mal compris :
« Oui, certaines personnes se disent un peu fatiguées — pas à cause des vins eux-mêmes, mais à cause de la manière dont ils sont souvent présentés. Beaucoup de gens goûtent leur premier vin de macération en s’attendant à quelque chose de lourd, étrange, voire défectueux. »
Ce qu’elle remarque surtout, c’est une confusion persistante : on associe trop souvent “vin orange” à un goût uniforme, alors qu’il existe une infinité de nuances. Pour elle, c’est justement maintenant qu’il faut réexpliquer. Replacer les choses dans leur contexte. Car aujourd’hui plus que jamais, ces vins ont un rôle à jouer.
« Avant, c’était plus niche. Les gens qui buvaient du vin orange étaient peu nombreux, mais très curieux. Aujourd’hui, c’est plus populaire, mais le niveau de compréhension est plus faible. Beaucoup répètent des clichés. Mais en même temps, il y a plus d’ouverture. C’est une belle opportunité, à condition d’expliquer ce que ces vins sont vraiment. »
Même constat du côté de Stephanie, qui sent chez les amateurs un double discours :
« Les gens veulent boire naturel, mais avec un goût classique. Ils passent parfois à côté de ce qui fait l’authenticité du vin. »
Joseph, lui, le voit sous l’angle du désenchantement :
« En tant que pro, au bar, je n’en achète plus du tout, sauf les muscats à petits grains macérés. J’adore ça. Mais j’ai l’impression que l’effet de nouveauté est passé. Les gens comprennent mieux comment c’est fait, donc c’est moins mystérieux, moins intrigant. »
Macérer ou ne pas macérer? Une affaire de climat, pas d’effet de style
Ce que tous trois partagent, c’est cette conviction que la macération est parfois imposée par les conditions naturelles.
Silvia le dit clairement :
« Ce n’est pas une tendance. C’est une adaptation naturelle. Une manière de suivre la saison, le raisin, le lieu. »
Elle observe que dans les années très chaudes et sèches — de plus en plus fréquentes — les peaux des raisins deviennent plus épaisses, plus riches.
« Dans ces conditions, forcer un blanc léger et frais peut sembler contre-nature. Il faut écouter le fruit. »
Et elle ajoute, avec la perspective d’une nouvelle maternité qui change son rapport au futur :
« Je pense de plus en plus à l’agriculture qu’on veut transmettre. Pour moi, macérer, comme beaucoup de pratiques naturelles, c’est une façon de rester proche de la terre et de protéger ce qu’on a. Si on veut protéger notre planète et notre sol, il faut apprendre à travailler avec la nature, pas contre elle. »
Chez Stephanie, c’est le même constat — mais avec un focus sur le rôle fondamental de la macération dans les fermentations spontanées :
« Quand il fait trop sec, les fermentations spontanées deviennent plus difficiles. Les levures ont besoin de nutriments qu’elles trouvent en grande partie sur les peaux. Dans bien des cas, on n’a pas le choix : macérer, c’est permettre au vin de naître sans ajouts. »
Joseph abonde dans le même sens, avec un exemple très concret :
« En 2018, on a commencé à macérer parce que les chenins manquaient d’acidité. C’était une façon de compenser, de retrouver de la tenue. »
Vinification : pas de recette, mais une écoute fine
Ce qui ressort de ces échanges, c’est à quel point la macération n’est jamais un automatisme, ni un style plaqué. Elle demande de l’observation, du lâcher-prise, et parfois de changer d’avis en cours de route.
Silvia explique :
« Je peux penser faire une longue macération, mais si les raisins ne réagissent pas bien, j’arrête après deux jours. C’est vivant, il faut écouter. »
Elle précise aussi que parfois, le but n’est même pas d’extraire, mais simplement d’aider les levures à faire leur travail.
« Il arrive qu’on garde le jus sur les peaux uniquement pour faciliter le départ de fermentation, sans chercher à extraire des tanins ou de la couleur. »
Chez Stephanie, on aime les équilibres délicats :
« On aime les macérations légères avec des vins autour de 11 à 12,5 % d’alcool. Trop de tanins sur un vin trop fort ou trop acide, ce n’est pas agréable. C’est toujours une question de justesse. »
Elle insiste aussi sur la vision long terme :
« Il faut qu’on fasse des vins naturels propres, stables et qui vieillissent bien. C’est notre objectif personnel. »
Joseph, fidèle à sa franchise, va à l’essentiel :
« Il faut faire très attention à ne pas extraire trop de tanins. Donc macération très courte… ou très longue. »
Et si vous êtes tanné des vins oranges?
Silvia répond en souriant :
« C’est comme dire “j’en ai assez des pâtes”. Peut-être que vous n’avez juste pas encore trouvé le bon vin. Ou que vous n’avez pas encore creusé assez loin. »
Stephanie, elle, invite à regarder plus large :
« Dire ça, c’est souvent ne pas comprendre les choix du vigneron. Le climat change, la nature nous impose un nouveau langage. Ce n’est pas une décision de style, mais une nécessité. »
Et Joseph, pince-sans-rire :
« Je te comprends. 👁️👁️ »
🟠 En bref : on n’a pas fini de parler de vins oranges. Et surtout, on n’a pas fini d’en découvrir — des subtils, des complexes, des joyeux, des méditatifs. Peut-être que celui qui vous réconciliera est juste à un bouchon d’ici... ou dans nos suggestions de la semaine!